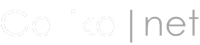Dans les mémoires de master ou les thèses en didactique des langues, le questionnaire est roi. Présenté comme un outil rigoureux, il masque souvent un manque cruel de fondement méthodologique : questions biaisées, réponses subjectives, analyses statistiques mal conduites… Cet article démonte les illusions d’objectivité et invite à une réflexion critique sur l’usage de cet instrument trop souvent maltraité.
Un outil trop souvent choisi par défaut
Le questionnaire séduit : simple à créer, facile à distribuer, il donne des résultats chiffrés qui rassurent. Mais dans bien des cas, ce choix n’est ni justifié, ni intégré à une démarche de recherche rigoureuse.
Des questions sorties de nulle part
Souvent, les questions ne viennent ni d’une étude préalable, ni d’une revue de la littérature. Elles traduisent les représentations du chercheur, non celles des répondants. L’absence de problématisation entraîne des questions vagues, subjectives ou biaisées.
Une subjectivité généralisée mais ignorée
Les réponses reflètent des opinions ou des représentations sociales, pas des faits. Cette subjectivité devrait être reconnue, mais elle est souvent niée, comme si les données chiffrées suffisaient à valider la recherche.
Des QCM mal pensés et des options tronquées
Questions à choix unique ou multiples, échelles floues, absences d’options essentielles, questions ambiguës : l’expérience du répondant est trop souvent frustrante ou faussée. Les résultats deviennent peu exploitables.
Des chiffres rassurants, mais creux
On affiche des pourcentages et des moyennes pour produire une impression de rigueur. Mais sans analyse ni mise en contexte, ces chiffres ne disent pas grand-chose. Le graphique devient décoration et non preuve.
Un traitement statistique peu rigoureux
– Les choix statistiques sont rarement justifiés.
– L’écart-type est mentionné mais jamais interprété.
– La représentativité de l’échantillon n’est pas démontrée.
– Les échelles de Likert sont mal construites ou mal exploitées.
– On distingue par exemple hommes/femmes mais on n’analyse pas les écarts.
– Des camemberts inutiles illustrent des variables non analysées.
– Les types de graphiques sont mal choisis, avec des légendes floues, ce qui nuit à la compréhension.
Bref : l’outil statistique est souvent un alibi, pas une preuve.

Camembert classique, figurant des données non analysées/interprétées.
Légende imprécise.
Une vigilance partagée : chercheurs et encadrants
La responsabilité est collective. Il faut former les étudiants à la méthodologie des enquêtes et aider les encadrants à mieux accompagner la conception et l’exploitation de ces outils.
Quelques principes de rigueur
– Ne pas commencer par le questionnaire, mais par l’analyse du terrain.
– Justifier chaque choix méthodologique.
– Tester et relire.
– Croiser les outils : questionnaire ≠ méthodologie unique.
– Analyser finement, pas seulement afficher.
Ne pas tomber dans l’illusion méthodologique
Le questionnaire ne garantit aucune scientificité. Il faut en repenser l’usage, cesser de le sacraliser et apprendre à reconnaître ses limites. Un bon questionnaire ne vaut que par sa pertinence, sa rigueur et son intégration réfléchie dans un dispositif global de recherche.
En résumé
Le questionnaire est l’un des outils les plus utilisés dans les mémoires de master et les thèses en didactique des langues. Pourtant, il est souvent mal conçu, mal justifié et mal exploité : les questions sont rarement issues d’une prérecherche sérieuse ; les réponses recueillies sont souvent subjectives et peu fiables ; les analyses statistiques manquent de rigueur, quand elles ne sont pas purement décoratives ; les échelles de Likert sont mal pensées, les graphes mal choisis et les données rarement mises en lien avec la problématique de départ. Ce texte invite à une remise en question salutaire : plutôt que de faire du questionnaire un passage obligé, faisons-en un outil exigeant, au service d’une vraie démarche de recherche.
— Résumé généré par l’IA.