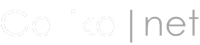Je ne suis pas grec et je ne prétends pas connaître parfaitement les réalités locales. Mais en tant qu’observateur concerné, formateur et amoureux du FLE depuis plusieurs décennies, je souhaite apporter ici une lecture lucide et engagée de la situation, en m’appuyant sur des faits accessibles et sur les retours d’acteurs de terrain.
Alors que le français occupait historiquement une place de choix dans l’enseignement public grec, il connaît aujourd’hui dans de nombreux contextes une perte de visibilité et de soutien institutionnel. Ce déclin n’est pas une fatalité : il est le résultat de décisions politiques assumées, que les discours pédagogiques peinent à compenser. Voici mon analyse d’un effacement progressif et des leviers pour le neutraliser.
Pourquoi le FLE recule en Grèce ? Une tendance observable, mais aux causes multiples
1. Le FLE semble moins soutenu par l’État grec
Depuis une dizaine d’années, on observe un recul de la présence du français dans l’enseignement public, en particulier aux niveaux primaire et secondaire.
Dans de nombreuses écoles, le choix théorique entre deux langues à partir de la 5e année du primaire (français/allemand) tend parfois à disparaître de fait, le français n’étant plus proposé dans certaines écoles, soit par manque d’enseignants, soit par choix locaux non explicités.
Aucune politique publique forte ne vise à revaloriser le français. Le français est rarement mis en avant dans les communications officielles du ministère.
2. Les nominations de professeurs de FLE sont bloquées ou minimes
Le nombre d’étudiants s’inscrivant dans les départements de langue et littérature françaises, à Athènes comme à Thessalonique, est en diminution constante depuis plusieurs années. Cette tendance ne laisse rien présager de bon pour le renouvellement des générations d’enseignants.
Les sessions du concours d’accès à la fonction publique (ΑΣΕΠ) sont rares, les affectations fragmentées et les heures souvent réduites.
Les jeunes diplômés en langue et littérature françaises n’ont plus de débouchés clairs [1], ce qui décourage les vocations.
3. Le contexte européen favorise certaines langues
L’Allemagne, économiquement influente en Grèce, bénéficie d’accords bilatéraux renforçant l’apprentissage de sa langue.
Le français, bien que langue officielle de l’UE, est moins soutenu dans les faits.
Un autre facteur souvent ignoré tient à la place excessive que prennent certains examens de certification dans les parcours d’apprentissage du FLE. Trop souvent, les élèves sont préparés presque exclusivement à des épreuves dont la validité, la fiabilité et la qualité technique soulèvent des interrogations parmi les praticiens, et dont les formats, bien que prétendant s’inscrire dans la perspective actionnelle promue par le CECR, s’en écartent souvent dans la pratique. Cette approche appauvrit l’expérience d’apprentissage : elle réduit la langue à un ensemble de tâches techniques à maîtriser, au détriment du plaisir, de la créativité et de la communication authentique. Nombre d’élèves expriment une lassitude face à des formats d’examen répétitifs, éloignés d’un usage vivant de la langue ; les enseignants eux-mêmes peuvent s’épuiser dans une logique de rendement sans horizon véritablement actionnel.
Que faire alors ?
Comme le font déjà fort bien plusieurs associations de professeurs de FLE engagées sur le terrain (APF-FU, APLF, APELF), il faut proposer des gestes concrets, à la portée de chacun. Cela suppose de distinguer ce qui est facilement faisable dans le contexte grec, de ce qui demande un effort collectif plus soutenu, voire un changement de culture institutionnelle. Voici une évaluation de faisabilité, pour orienter au mieux les énergies.
1. Repolitiser la question du FLE
– Participer à des collectifs locaux d’enseignants pour recenser les disparitions de cours de FLE. Cela existe déjà dans plusieurs villes.
– Prendre la parole publiquement à travers des tribunes, lettres ouvertes ou courriers ciblés à l’administration locale et nationale. Ces démarches ont plus de portée si elles sont coordonnées et collectives.
– Relayer les faits chiffrés et situations injustes dans la presse régionale ou sur les réseaux sociaux. De nombreux enseignants le font déjà, mais cela gagnerait à être mutualisé.
– Sortir du discours technopédagogique : nommer le problème politique.
– Documenter et publier les cas de disparition d’options, de baisse d’effectifs, de blocages administratifs.
– Former des « référents FLE » locaux pour coordonner les efforts dans chaque établissement.
– Créer une boîte à outils mutualisée (modèles de messages, statistiques, fiches d’argumentation, etc.).
Des groupes actifs émergent déjà sur les réseaux sociaux (sur Facebook surtout) pour recenser les injustices, mutualiser les idées, alerter l’opinion et coordonner les actions : ces efforts méritent d’être reconnus, amplifiés et rejoints.
2. Mobiliser les collectivités et les parents
– Organiser un moment fort dans l’année scolaire (semaine du FLE, concours, exposition) afin de valoriser la langue auprès des familles. Ce type d’initiative a déjà été expérimenté avec succès dans certains établissements (dans les écoles dites franco-grecques surtout).
– Prendre contact avec les comités de parents d’élèves pour expliquer les enjeux du maintien du FLE et chercher leur soutien actif. Cette démarche est particulièrement efficace là où le tissu associatif est dynamique.
– Réunir les anciens élèves ou les parents ayant une affinité avec le FLE pour qu’ils appuient les demandes d’ouverture ou de maintien de cours. Cela peut s’organiser dans des contextes urbains ou dans les écoles ayant une histoire francophone.
– Développer les relations avec les collectivités locales dans les zones où le français a un ancrage culturel ou économique. L’engagement varie fortement d’une région à l’autre, mais peut parfois être décisif.
– Mettre en place des collectifs mixtes de parents et d’enseignants pour demander explicitement le maintien ou la réintroduction de l’option française. Même si cela demande de la persévérance, ces collectifs ont déjà porté leurs fruits localement.
– Cibler des zones pilotes (écoles jumelées, lycées internationaux, établissements franco-grecs) où une action visible et coordonnée peut redonner de la visibilité au FLE.
3. Créer des alliances politiques et culturelles
– Identifier un élu local sensible à la diversité linguistique (député, conseiller municipal) prêt à porter la question dans les assemblées. Cela nécessite un travail de réseau, mais certains élus locaux, notamment en lien avec des jumelages, peuvent y être sensibles.
– S’appuyer sur des associations culturelles ou des jumelages franco-grecs pour renforcer la légitimité du FLE dans certaines régions. Ces partenariats existent mais ils sont souvent dormants ou peu médiatisés.
– Organiser un événement public, cette fois (table ronde, projection-débat, manifestation artistique), qui mette en lumière l’utilité du français aujourd’hui. Cela permet de toucher un public plus large et de redonner du sens à l’apprentissage.
– Travailler avec les médias, associations, instituts français pour visibiliser la cause. Ce travail de communication donne de la légitimité aux actions locales et peut attirer l’attention d’autres partenaires.
– Inscrire le FLE dans un discours plus large sur l’école publique et la souveraineté culturelle. Cette approche plus idéologique mobilise moins facilement sur le terrain, mais elle reste utile pour alimenter tribunes, conférences ou plaidoyers nationaux.
Le déclin du FLE en Grèce n’est ni un simple effet de mode ni un échec pédagogique. Il semble résulter d’un ensemble de décisions et d’évolutions structurelles, dont certaines peuvent être interprétées comme des choix politiques, d’autres comme des ajustements techniques ou budgétaires.
Prendre pleinement conscience des causes profondes du recul et y répondre collectivement est un premier pas essentiel. Le français peut encore retrouver toute sa place dans le paysage éducatif grec... si nous le voulons vraiment.
__________
[1] Et pourtant, Dieu sait s’il y en a ! Ce sera l’objet d’un prochain article.
Quelques arguments à utiliser pour repolitiser et mobiliser
– Le français n’est pas une langue en surplus : c’est une langue de travail de l’UE, de l’ONU et de nombreuses organisations internationales.
– Faire reculer la place du français, c’est couper un pont culturel historique entre la Grèce et l’espace francophone.
– Le français donne accès à des bourses, à des études supérieures souvent gratuites ou à très faibles frais dans plusieurs pays francophones (France, Belgique, Luxembourg, Canada, Suisse), à des mobilités universitaires, à des carrières dans le tourisme, l’interprétation, la diplomatie, le commerce.
– C’est une langue d’ouverture et d’émancipation, pas une langue de repli scolaire.
– La diversité linguistique est une richesse, pas une charge.
– L’effacement progressif du français dans le réseau d’enseignement public creuse encore plus les inégalités entre ceux qui peuvent payer des cours privés et les autres.
En résumé
Le français langue étrangère perd du terrain dans le système éducatif grec : raréfaction des postes, effacement discret dans les programmes, baisse des vocations universitaires, pression des certifications mal adaptées. Ce texte propose une lecture lucide mais non défaitiste de la situation. Il s’appuie sur des faits observables et des retours de terrain, tout en distinguant ce qui est faisable localement et ce qui relève d’un engagement politique plus large. Il s’adresse à tous ceux qui veulent agir, sans attendre une réforme venue d’en haut.
— Résumé généré par l’IA.